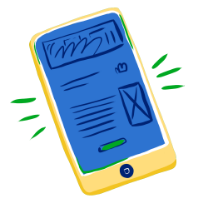Sur les traces de saint Jacques à Bordeaux
Explorer les rues de Bordeaux, c’est se rendre compte des liens historiques entre la métropole et le pèlerinage de Compostelle. Le paysage architectural est marqué d’éléments évoquant le saint Jacques le Majeur. Parfois représenté en apôtre, en pèlerin ou encore en Matamore.
Par où commencer ? Dans le cœur historique, côté cathédrale Saint-André et basilique Saint-Seurin. Puis, la Maison du Pèlerin, à l’angle de la rue de La Coquille, détient un vestige pour le moins intéressant… Sans oublier, bien sûr, la basilique Saint-Michel et le musée d’Aquitaine.
En chemin, remarquez les sceaux jacquaires en bronze imaginés par l’architecte Christine Mathieu. Car eux aussi vous guident à la découverte des traces de Saint-Jacques à Bordeaux.
À la fin de l’article, retrouvez notre petit glossaire du pèlerin pour vous familiariser avec certains mots que vous ne connaissez peut-être pas.
Du guide du Pèlerin à l’inscription l’UNESCO
Depuis la découverte du tombeau de saint Jacques le Majeur au 9ᵉ siècle, le pèlerinage chrétien pour Compostelle se popularise. Saint-Jacques est l’évangélisateur de la péninsule ibérique. Le matamore symbolisant la Reconquista.
Issu du « Codex Calixtinus », une compilation de livres écrits au 12ᵉ siècle, le guide du Pèlerin propose quatre itinéraires jacquaires au départ de la France. Les parcours sont jalonnés d’étapes. Elles permettent aux pèlerins de se reposer, de recevoir des soins. Mais aussi de visiter différents sanctuaires pour y pratiquer le culte des reliques et autres dévotions.
Au fil des siècles, les chemins attirent des milliers de profanes. C’est donc au vu de son influence séculaire que l’UNESCO reconnait, en 1998, la valeur universelle exceptionnelle - matérielle et immatérielle - du pèlerinage de Compostelle. Sur 95 communes et 32 départements, 7 tronçons et 71 édifices sont inscrits au titre de bien culturel en série « Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. »
À Bordeaux, la cathédrale Saint-André et les basiliques Saint-Seurin et Saint-Michel font partie de cette inscription. La ville, située sur la voie de Tours - la voie Turonensis –, en constitue une étape essentielle.
 photo : Marie Blanchard
photo : Marie Blanchard
À la cathédrale Saint-André
Avec son déambulatoire et ses chapelles rayonnantes, l’architecture de la cathédrale répond à la popularité du pèlerinage.
À l’origine, la cathédrale était placée sous le patronage de saint Jacques et de saint André. Mais à la question : qui, entre elle ou la basilique Saint-Seurin, peut se valoir d’être le berceau du christianisme local, les deux chapitres rivalisent. C’est donc dans l’idée d’affirmer son ancienneté religieuse que la cathédrale privilégie, au 11ᵉ siècle, le saint André. Ainsi, selon la légende, elle respecte le vœu d’Amand, premier évêque de Bordeaux.
Saint-Jacques est passeur d’âmes
Vers le portail royal, Jacques le Majeur porte un bourdon et une panetière à coquille, les attributs du pèlerin. À l’intérieur de la cathédrale, la chapelle Sainte-Anne était autrefois dédiée à saint Jacques. Sur ses murs, une fresque du 14ᵉ siècle dévoile le saint en passeur d’âmes. Accompagné de saint André, il tient un linge dans lequel se trouve l’âme du chanoine Pons de Pommiers. Ils l’envoient vers le ciel.
 ©Nicolas Duffaure
©Nicolas Duffaure
À la Maison du Pèlerin : un vestige de la chapelle Saint-Jacques
La maison du Pèlerin abrite un morceau de pierre provenant d’un haut lieu du pèlerinage au Moyen Âge : la chapelle de l’hôpital Saint-Jacques, rue du Mirail.
Février 2001 : les voûtes du chœur de la chapelle - convertie en garage - s’effondrent. Elles entrainent avec elles la clef de voûte représentant - fait rare en iconographie - saint Jacques en majesté. Quelle n’est pas la surprise de Michel Redrégoo – président d’honneur de l’association Bordeaux Compostelle Hospitalité Saint-Jacques - quand il constate que le saint a survécu à la chute. Il a simplement perdu ses pieds. Il en capture un cliché pour le disposer à l’entrée de la maison d’accueil, à côté de la pierre.
Cette chapelle, élevée au 14ᵉ siècle, faisait partie d’un hôpital bâti en 1119. Quand on érigea les seconds remparts de Bordeaux au 13ᵉ, l’édifice se situait hors les murs, à proximité de la Grosse Cloche. Dédié au soin des jacquets, les pèlerins y avaient droit de sépulture. Les travaux de 1927 ont d’ailleurs exhumé des coquilles des tombes. La chapelle est aussi un lieu privilégié de la confrérie de Saint-Jacques.
Aujourd’hui, les habitations rue du Mirail masquent l’édifice religieux. Une plaque au sol rappelle l’existence passée de l’hôpital Saint-Jacques.
 ©Maison du pélerin
©Maison du pélerin
Le culte des reliques
Voici le site qui a vu se développer l’histoire de Bordeaux et de la chrétienté. L'église, devenue basilique en 1873, est implantée sur une nécropole antique que vous pouvez visiter. Le culte des reliques et les récits légendaires autour des saints fondateurs ont ancré sa renommée. Son influence est telle que c’est dans ce sanctuaire que se déroulaient les cérémonies d’intronisation des évêques et des ducs.
À la basilique Saint-Seurin
Mentionnée dans le guide du Pèlerin, la basilique est LE lieu fréquenté des jacquets. Parmi les reliques honorées : le bâton miraculeux de saint Martial, évangélisateur de l’Aquitaine. L’olifant de Roland aussi, car Charlemagne l’aurait déposé sur l’autel de saint Seurin à son retour de Roncevaux. Avant qu’il ne disparaisse vers 1610…
Dans la crypte, reposeraient les corps des premiers évêques de la ville. Jusqu’au 20ᵉ siècle, on présentait ses enfants à saint Fort, dans l’espoir de les rendre forts comme lui. Pour Seurin, la tradition raconte que c’est lors d’un songe qu’un ange prévient Amand de son arrivée. Le tympan du portail occidental le représente d’ailleurs, lui cédant son siège épiscopal. Seurin deviendra le 4ᵉ évêque de la ville.
 ©Nicolas Duffaure
©Nicolas Duffaure
Basilique Saint-Michel
Au 13ᵉ siècle, d’importantes confréries rythment la vie du quartier. Elles érigent leurs chapelles dans la basilique Saint-Michel. À partir de 1612, la confrérie religieuse de Saint-Jacques se verra aussi attribuer – par le cardinal de Sourdis – sa chapelle dans le lieu de culte.
Sur le portail nord, la coquille du pèlerin côtoie celle de l’ordre de Saint-Michel. Elle est un symbole fort du pèlerinage. Elle est la crédencial attestant de sa participation. Une condition exigée pour faire partie de la confrérie.
Des vitraux illustrant la vie de saint Jacques
Une statue marque l’entrée de la chapelle. C’est une reproduction d’une statue en bois datée du 15ᵉ siècle et exposée au musée d'Aquitaine. Elle représente Jacques l’apôtre avec les attributs du pèlerin. Son dos étant plat, elle s’appuyait probablement sur une niche ou un retable. Dans la chapelle, des vitraux – signés du maître verrier Jean-Henri Couturat – relatent des moments forts de la vie du saint. Un médaillon le montre en matamore. Le retable, lui, présente des attributs du pèlerin.
 © Teddy Verneuil - @lezbroz
© Teddy Verneuil - @lezbroz
Après Bordeaux, le chemin continue vers Gradignan. L’étape s'arrête au prieuré de Cayac. Là-bas, vous y trouverez la sculpture de Danielle Bigata, le « Pèlerin au repos ». Comme lui, attardez-vous sur le site pour vous imprégner de son histoire. Ou, si vous êtes jacquet, passez-y la nuit.
Retrouvez d'autres informations sur l'accueil des pèlerins à Bordeaux dans cet article.
 © Ville de Gradignan
© Ville de Gradignan
Glossaire du pèlerin de Saint-Jacques-de-Compostelle
• Le Matamore : Jacques le Majeur représenté en chevalier combattant les Maures lors de la Reconquista.
• Jacquet : désigne un pèlerin sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle.
• Patrimoine mondial de l'UNESCO : inscription par l'Organisation des Nations Unies de sites culturels et naturels considérés exceptionnels pour l'humanité.
• Voie Turonensis : nom de la route passant par Tours et Bordeaux et menant à Compostelle ; l’une des quatre grandes voies françaises.
• Bourdon du pèlerin : bâton utilisé par les pèlerins pour leur marche ou pour leur défense.
• Panetière : sac parfois orné d’une coquille, que portaient les pèlerins pour transporter des vivres ou des objets.
• Relique : objet ou dépouille d’un saint, conservé dans les églises.
• Nécropole : vaste et ancien cimetière d’importance historique et archéologique.
• Confrérie : association de personnes partageant une dévotion ou profession, dédiée à un saint et animée d’un esprit de charité.
• Une clef de voûte : élément architectural central et essentiel, souvent sculptée d’armoiries ou d'une figure religieuse.
• Crédencial : carnet officiel du pèlerin certifiant de sa participation au pèlerinage.
• Retable : décor sculpté ou peint situé derrière ou au-dessus de l’autel ; décoré de panneaux illustrant des récits religieux.
• Olifant de Roland : cor en ivoire précieux et symbolique utilisé par Roland, neveu de Charlemagne, pour appeler des renforts lors de la bataille de Roncevaux (778).
 © Gironde Tourisme
© Gironde Tourisme